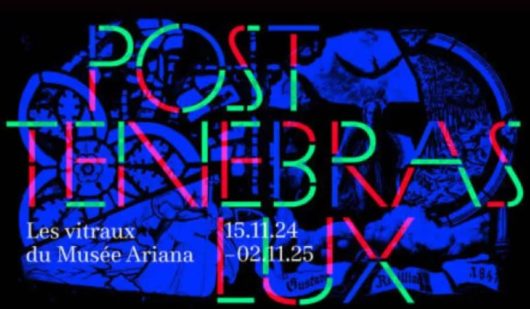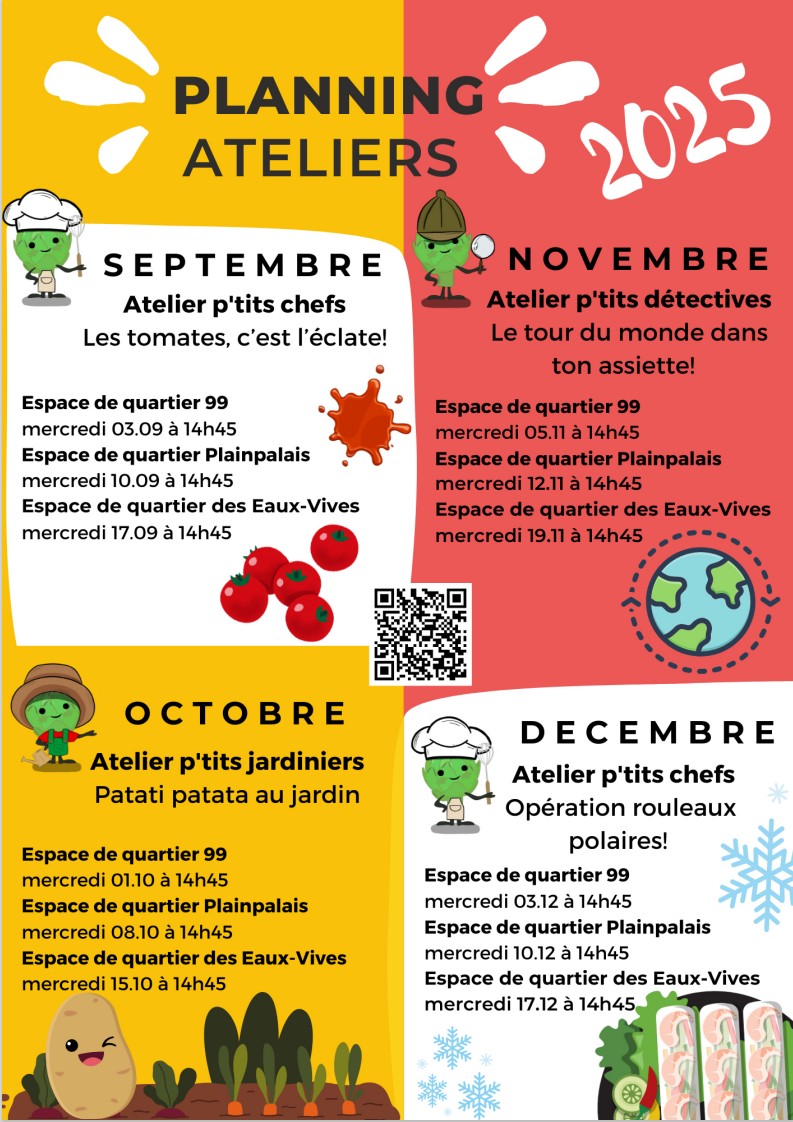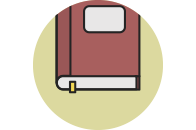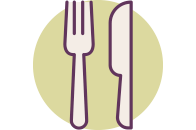Adolescents si semblables, si différents de leurs aînés

Lettre du mardi 11 février 2025 - Source: Migros.ch Magazine N°34-2023
Cette semaine nous reproduisons un article de Patricia Brambilla publié dans le Migros Magazin n°34 le 21.8.23.
“Comment vont les ados? Tourmentés, en quête identitaire, mais surtout confrontés à un monde devenu plus incertain. Le psychologue Jon Schmidt pose son diagnostic.
Jon Schmidt, l’humain est le mammifère qui a la plus longue adolescence. Qu’est-ce que cela vous inspire?
Alors que certains mammifères se mettent à marcher après quelques heures, chez l’humain, le processus de maturation est plus long et il devient même de plus en plus long. On sait quand l’adolescence commence, mais on ne sait plus quand elle finit, d’autant que la puberté n’est plus le seul critère. C’est une fenêtre de temps où l’enfant devient adulte, trouve sa place
dans la société et peut fonctionner sans l’aide de ses parents. Mais dans le contexte actuel complexe, on assiste à un double mouvement: les ados se posent davantage de questions sur leur avenir, ce qui freine leur entrée dans le monde, et en même temps, ils sont moins insouciants, ils portent des préoccupations d’adultes.
On entre désormais plus tôt dans l’adolescence et on y reste plus longtemps?
On y entre toujours vers 13 ou 14 ans, mais la question de la sortie est effectivement plus compliquée. Les repères visuels, comme les vêtements ou les modalités de transport, sont brouillés. Le costume-cravate, journal sous le bras, ne fait plus l’adulte, de même que la trottinette ne fait plus l’ado! Beaucoup d’adultes veulent être des parents qui restent jeunes. Les frontières entre les âges sont plus floues.
Le nombre de jeunes en consultation augmente. Faut-il en déduire que les ados vont mal?
Je ne dirais pas que les ados d’aujourd’hui vont moins bien, mais les terrains glissants et les peaux de banane sont plus nombreux sur leur chemin. Il y a aussi moins d’étayage autour de ces
ados pour les rassurer. Il est difficile aujourd’hui pour un parent de rester de marbre et de dire à son ado que tout va bien se passer concernant les nombreuses crises climatique, économique et géopolitique que nous traversons. Les sources d’inquiétude se multiplient dans notre société et impactent inévitablement les jeunes.
Voyez-vous émerger de nouvelles problématiques?
La principale problématique de l’adolescence, qui est le questionnement identitaire, ne change pas. La complète refonte neuronale et hormonale de la puberté est immuable. L’évolution se
trouve plutôt dans la tendance que nous avons à tout catégoriser aujourd’hui. Autour des familles gravite toute une batterie de professionnels qui posent un regard très tôt sur l’enfant.
Mais n’est-ce pas une bonne chose de se préoccuper de leur santé psychique?
Si, bien sûr, mais il ne faut pas surpsychologiser un comportement qui n’est peut-être qu’une étape, un passage naturel. On met parfois trop vite des étiquettes sur les troubles d’hyperactivité, d’hypersensibilité, au risque de tomber dans une labellisation de l’enfant. On fait comprendre aux parents qu’ils ne sont pas spécialistes, alors qu’ils devraient être au centre.
Quels sont les motifs de consultation les plus fréquents?
Anorexie, éco-anxiété, transidentité, délinquance sont autant de motifs de consultation. Mais, à l’exception de la place des écrans qui était moins préoccupante il y a trente ans, je pense
que tous ces problèmes n’ont rien de nouveau. L’éco-anxiété est un vécu d’angoisse, qui existe depuis toujours, même s’il est aujourd’hui exacerbé. Quant aux questions identitaires, elles ne sont
pas nouvelles non plus, sauf qu’on ne les appelait pas comme ça et qu’elles étaient taboues.
83% des jeunes femmes et 65% des garçons quittent le foyer avant 25 ans. Le phénomène «Tanguy» est-il toujours d’actualité?
Il est courant de voir en thérapie des ados qui restent au nid jusqu’à 30 ans ou plus. Il arrive que les raisons soient contextuelles, quand l’enfant devient soutien de famille. Ces jeunes qui ne prennent pas leur envol cachent généralement d’autres problèmes. Au niveau du couple parental, il y a parfois une résistance au changement de manière inconsciente. Je pense en fait
qu’il y a davantage de «Tanguy» aujourd’hui parce que le chemin est moins direct, les études se prolongent et les bifurcations professionnelles sont fréquentes.
Est-ce que les parents n’investissent pas trop leurs enfants?
Oui. Il est clair que pour qu’un enfant quitte le nid, il doit percevoir de la confiance dans le regard de ses parents. Quand il y a un doute chez les parents et que l’enfant le sent, c’est un
frein énorme.
La faute aussi aux rites de passage, qui ont presque tous disparu?
On a enlevé beaucoup de repères essentiels dans nos sociétés occidentales. Il faudrait en créer de nouveaux pour structurer les différentes étapes. Au Vanuatu, en Océanie, les jeunes, attachés
par une simple liane, vont se jeter du haut d’une tour de 12 mètres. S’ils y parviennent, ils entrent dans la catégorie des adultes. C’est un peu comme le saut des 10 mètres à la piscine ou comme
dans les films de Star Wars. Le héros part dans un monde qui lui fait peur et se retrouve face à l’inconnu. Il se confronte au danger et, en y survivant, il devient adulte. Historiquement, c’est souvent un garçon, mais c’est valable pour les filles!
Un ado qui dysfonctionne, est-ce forcément une histoire de famille?
Ce n’est pas forcément la faute des parents. Mais la famille a toujours un rôle à jouer et peut souvent être une ressource. Par contre, dans toutes les familles, il y a des places, qui se distribuent
très tôt et inconsciemment, et une fois qu’elles sont attribuées, elles sont très difficiles à changer. Dans une fratrie, si l’un des enfants est perturbateur, l’autre sera plus calme, de même entre
parents, les rôles sont souvent complémentaires. Cela crée des dynamiques relationnelles, qui entraînent des liens d’affinité, des coalitions, des tensions, des disputes, des rancœurs.
Comment changer les dynamiques?
La famille est un mobile, avec des pièces attachées les unes aux autres en perpétuel mouvement. Quand une pièce dysfonctionne ou qu’une relation est bloquée, on utilise parfois les jeux de rôle
en thérapie pour déconstruire les places. Il faut transformer les enjeux en jeux, cela permet de voir les autres membres de la famille différemment.
Sur l’échelle de Richter, où situez-vous l’étape de l’adolescence dans une famille?
C’est le séisme le plus fort! D’ailleurs, toute sa vie, on revient sur cette période de l’existence. Fil rouge de l’adolescence à travers l’Histoire, la nouvelle génération arrive avec des revendications
et des révoltes. C’est l’âge de la famille où l’on vit la crise d’idées la plus importante, avec des débats, des désaccords parfois violents. Mais c’est une étape fascinante, parce qu’elle fait évoluer la famille vers un autre modèle relationnel. Et c’est comme ça que les idées progressent et font changer les sociétés.
Vouloir le bonheur de ses enfants, est-ce une injonction empoisonnée?
Oui, je pense. Beaucoup de parents sont dans le syndrome du métronome: ils veulent faire juste, ne pas perdre de temps, sont très pressés de voir leurs enfants grandir, réussir à l’école.
Mais la réalité de la vie, ce n’est pas le culte de la performance et du bien-être constant. Mieux vaut souhaiter une vie où l’on ralentit, où l’on se pose la question du sens: qu’est-ce qui
nous relie, ici et maintenant? Parfois regarder une série ensemble, sans rien se dire, suffit à rappeler que l’on forme une famille. Beaucoup d’enfants attendent de leurs parents qu’ils
définissent le lien plutôt que d’être dans cette course folle. Être là ensemble, c’est sans doute le plus beau cadeau à leur faire.”
Livre de la semaine

Adolescence en quête de sens
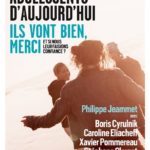
Adolescents d’aujourd’hui ils vont bien, merci : et si nous leur faisions confiance ?
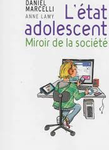
L’état adolescent: Miroir de la société