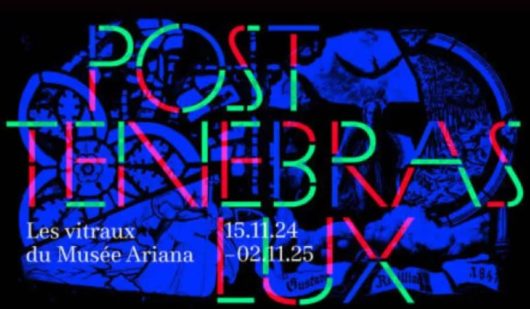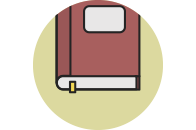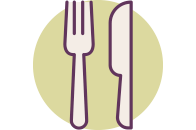Ces familles qui vivent avec la schizophrénie

Lettre du jeudi 15 décembre 2016 - Source: Echo Magazine
«Il n’y a pas une schizophrénie, mais différentes formes»: Louise-Anne Sartoretti jette un regard aux cinq femmes qui l’entourent. Il est 20h à Sion et la rencontre des proches de personnes souffrant de schizophrénie vient de débuter. Elle durera deux heures. Plusieurs mamans sont là. Une grand-maman aussi. «Les hommes sont plus rares», constate Louise-Anne Sartoretti, présidente de l’association valaisanne SynapsEspoir qui soutient depuis 2009 les proches de personnes en souffrance psychique. La schizophrénie, qui généralement se déclenche entre quinze et vingt-cinq ans sans que l’on sache vraiment pourquoi, touche cinq fois plus d’êtres humains que la maladie de Parkinson. 80’000 personnes en Suisse. Une sur cent dans le monde.
Les victimes collatérales, celles dont le quotidien est chamboulé par la maladie d’un conjoint, d’un enfant, d’un papa ou d’une maman, sont près de 300’000 en Suisse. Les femmes autour de la table ont toutes un fils, une fille ou un petit-fils malade. Parfois mineur, parfois majeur. «Mon fiston me dit sans arrêt qu’il m’aime, il m’embrasse et me serre dans ses bras», explique Rachel”. «Quelle chance, enchaîne Carole en lâchant un soupir. A une certaine période, le nôtre, on ne pouvait plus le toucher.» Rachel: «Oui, mais après avoir dit qu’il m’aime, il ajoute que ce serait mieux si ses frères et sœurs n’existaient pas…».
«Je l’aime, mon gosse»
Silence dans la salle. Rachel reprend: «Mon gamin souffre, il a fait plusieurs tentatives de suicide. Je ne compte plus les allers-retours entre l’hôpital le foyer et la maison. Et avec le reste de la famille, ça peut devenir très compliqué». Elle évoque les fugues, les crises et le désespoir d’une mère désemparée. «Il aura bientôt 18 ans. Il va falloir régler le problème de la tutelle, trouver une solution, c’est très stressant.» Aujourd’hui, la thèse de la «vulnérabilité biologique» est privilégiée par les scientifiques. Couplée à une montée de stress déclenchée par un choc — chagrin d’amour, deuil, accident, etc. — ou la consommation de drogue, cette fragilité expliquerait l’émergence de la maladie. «Mon fils est certain qu’un jour il se donnera la mort, révèle Rachel. C’est dur, mais il faut avancer, je fais tout ce que je peux pour l’aider. Je l’aime, mon gosse.» 11 aura fallu dix ans à cette femme combative pour que l’on reconnaisse la maladie de son enfant. «J’ai eu tout le temps de me culpabiliser. Les premiers psychologues que j’ai approchés m’ont dit qu’il était souffrant parce qu’il vivait dans une famille recomposée!»
A mesure qu’elle vide son sac, les regards, les acquiescements et les signes de tête montrent que les femmes présentes autour de la table ont toutes vécu des épisodes similaires. A un moment donné, leur enfant a aussi commencé à entendre des bruits ou des voix et à parler tout seul pour y répondre. Se sentant persécutés ou menacés, voyant des choses qui n’existaient pas, certains se sont repliés sur eux-mêmes. Si elles n’altèrent pas l’intelligence, les schizophrénies désorganisent la pensée, modifient la perception des choses et de soi-même. Et ce ne sont pas, comme ces mamans se le sont toutes entendu dire, «trois coups de pied aux fesses» qui risquent d’améliorer les choses. Ou bien: «Il faut la secouer», «Il a deux bras et deux jambes comme tout le monde». Autant de remarques stupides auxquelles elles doivent, parfois encore, faire face.
Divorcés coupables
«Le coup du divorce, c’est classique, intervient la seule grand-maman de l’assemblée. Il faut toujours trouver un coupable. La moitié des femmes ici présentes sont encore mariées. Cette maladie, ce n’est de la faute de personne.» Choquantes pour les non-initiés, les histoires entendues sur les hauts de Sion semblent presque banales pour ces mères courages qui, loin de se morfondre, restent à l’affût d’un conseil, d’un nouveau «truc» pour améliorer leur relation avec l’être aimé. Aux moments graves où l’on sent de gros nœuds se nouer dans les gorges succèdent des instants de grâce. Une énième tenue inappropriée, une fugue qui se termine bien, une remarque inattendue mais touchante: les extravagances de leurs gosses les font parfois sourire et même rire. Un rire qui permet de dédramatiser bien des situations tout en se serrant les coudes. Pétrie d’expérience, la présidente de SynapsEspoir précise d’une voix réconfortante: «Il y a aussi de longues phases de calme et des petits moments de bonheur. Parmi les malades qui participent aux traitements, environ un tiers arrivent à avoir un travail et une vie normales».
Pas plus violents
En Suisse, un autre tiers parvient à se débrouiller plus ou moins seul grâce à la rente de l’assurance-invalidité. Quant au dernier tiers, il est composé de personnes qui requièrent un accompagnement quasi permanent. Le problème étant, toujours, de diagnostiquer la maladie assez tôt pour la soigner. «Si une famille comprend qu’un enfant ou l’un des parents peut souffrir (par exemple) de pertes de mémoire en raison de la maladie, alors leur relation aura des chances de s’améliorer», affirme Louise-Anne Sartoretti. D’où l’importance de former les familles. Rares sont ceux qui s’intéressent au problème avant qu’il ne touche directement les siens. Inquiétants car méconnus, les termes rattachés à la schizophrénie — délire, hallucination, psychose, dépression — n’encouragent pas à aborder le sujet sans a priori.
«Le problème, déplore une participante, c’est que la presse associe trop facilement la schizophrénie aux actes agressifs. Mais nos gosses ne sont pas plus violents que les autres. S’ils font du mal, c’est d’abord à eux-mêmes.» Un fait que confirment les psychiatres. «Pensez, reprend la présidente, aux gens ‘bizarres’ que l’on croise dans la rue et que l’on évite juste parce que leur comportement sort de la norme.» Les abus de langage («l’UDC provoque un dilemme relevant de la schizophrénie», lit-on dans l’Hebdo du 1er décembre) n’aident pas non plus à sortir des clichés. Sans parler des représentations cinématographiques, qui font presque toujours passer les victimes de troubles mentaux pour des fous dangereux.
Ça se soigne
En plus de la médication, des thérapies permettent de gérer les crises. «Et, bien sûr, il y a Profamille», signale Louise-Anne Sartoretti. Mis au point par l’Unité de psychiatrie sociale et préventive de l’Université Laval au Québec, ce solide programme destiné aux proches et animé par un médecin psychiatre, des infirmiers et des assistants sociaux a été repris en Suisse. Il a (notamment) pour effet de diminuer de moitié le nombre d’hospitalisations. «Quatorze séances de plusieurs heures chacune sur deux ans, ça prend du temps, prévient une dame dont la fille en souffrance psychique vient d’avoir un enfant. Mais ça vous change la vie. On apprend à connaître la maladie et à réagir correctement.» La grand-maman solidaire des couples divorcés approuve. Son petit-fils va mieux. Après plusieurs années passées en foyer, il a pu prendre un appartement. «Ça ne fait que quelques mois, mais c’est déjà une petite réussite. Et il fait sa lessive tout seul!» Ces mamans n’ont pas peur de le dire: elles ont dû faire le deuil de leur enfant. C’est une autre personne qu’elles accompagnent désormais. Différente, mais tout aussi aimée.
Cédric Reichenbach
En savoir plus: http://www.lebiceps.ch/ http://www.hug-ge.ch/psychiatrie-generale/schizophrenie
Livre de la semaine

MILLE ET UNE FAMILLES