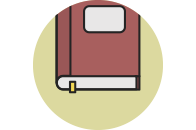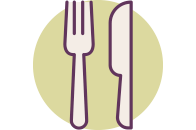« Identité sexuelle : nos représentations, nos doutes, nos désirs… »
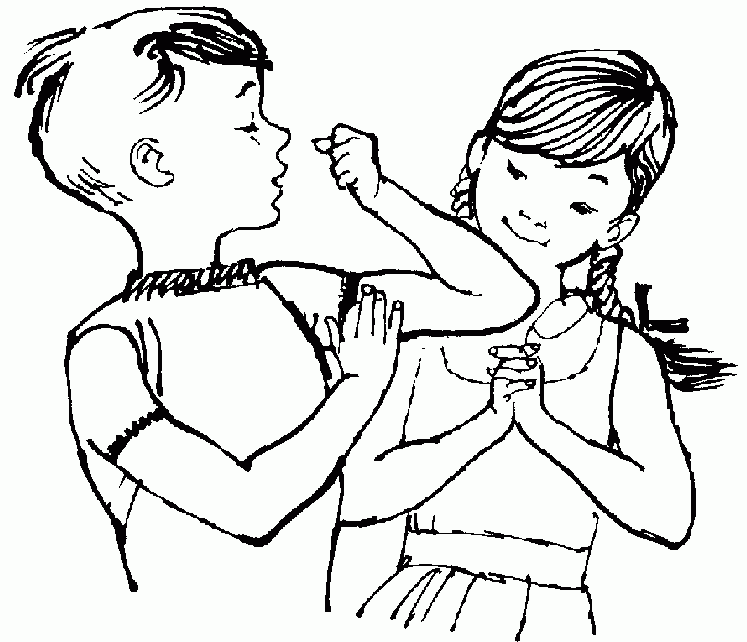
Lettre du jeudi 2 juin 2016 - Source: Maison de quartier des Eaux-Vives
Retour d’une soirée thématique à la Maison de quartier des Eaux-Vives, consacrée à la construction de l’identité, avec Marie-José Lacasa et Valérie Chaumeil, psychologues à l’école des parents.
Dans une première partie, Marie-José Lacasa nous propose de définir ensemble ce qu’est l’identité sexuelle, comment elle se développe et comment accompagner nos enfants dans cette construction qui nous renvoie à notre histoire personnelle. Le sujet de cette soirée n’est de loin pas un sujet facile à aborder. La sexualité humaine est un processus d’apprentissage, elle s’apprend, elle n’est pas si naturelle que l’on croit dans le sens où elle n’est pas que physiologique, elle renvoie à des aptitudes à développer qui ne sont pas acquises à la naissance.
Quel parent n’a pas été embarrassé lorsque qu’il est confronté aux questions de ses enfants !
Comment fait papa pour mettre sa graine dans le ventre de maman?
Pourquoi fermez-vous la porte quand vous êtes dans votre chambre?
Quel adulte n’a pas été aussi face à ses propres questionnements !
Comment accompagner son enfant dans la découverte de sa sexualité, sans la réprimer?
Quoi dire si je vois mon fils toucher son sexe?
Comment faire pour nommer ses limites, quand et comment en parler?
L’identité sexuelle (le fait d’être une fille ou un garçon) est prédéterminée par des composantes biologiques, hormonales et génétiques. Dans toutes ses composantes, la sexualité se développe dès les toutes premières semaines de vie. Se comporter comme un petit garçon à la différence d’une petite fille se met progressivement en place et ceci à travers des jeux appropriés : exploratoires, d’imitation et d’initiation. Si c’est une fille, elle va s’identifier à sa mère, aux femmes et développer des capacités de réceptivité, c’est par exemple la fille qui prend sa poupée dans ses bras pour la faire dormir… Si c’est un garçon, il va s’identifier à son père, aux hommes et développer des capacités d’ « intrusivité », c’est par exemple le garçon qui joue avec son épée ou son pistolet… Cependant, nous avons tous, en tant qu’adultes, nos perceptions, nos valeurs et codifications vécues et reçues dans notre enfance qui peuvent soutenir ou inhiber la sexualité de nos enfants, comme par exemple, « un garçon ne pleure pas » ou « les filles ne doivent pas exprimer ce qu’elles pensent des garçons ».
Toutes les découvertes des sensations sexuelles de la première enfance vont être physiologiques, motrices et sensorielles. La composante physiologique est la première qui se met en place .Nous pouvons voir à travers des images de la vie intra-uterine, l’excitation sexuelle, provoqué par l’afflux de sang dans les parties génitales ou d’autres parties du corps. L’excitation sexuelle repose sur un réflexe, c’est donc, non volontaire.
Le processus de sexualisation passe pour une succession d’apprentissages par lesquels l’enfant découvre son sexe, explore et répète des touchers, expérimente soi même et ou avec ses pairs et consolide des sensations sexuelles. Il se développe en différentes étapes, en fonction de l’âge et du rythme de chacun. C’est à travers les jeux d’initiation que l’enfant apprend et construit sa sexualité, développe une meilleure maîtrise de soi, comprend mieux les rôles de chacun, et commence à intégrer les règles qui vont lui permettre de poser les bases de sa future vie amoureuse et sexuelle. Le rôle des adultes dans l’accompagnement de la sexualité des enfants c’est de prendre conscience de la nécessité de laisser les enfants développer leurs habiletés : rêver, désirer, séduire, aimer, savoir prendre du plaisir, en tenant compte de leur âge, de leur maturité et dans le respect des règles sociales et familiales.
En ce qui concerne nos représentations, il est important qu’elles soient adaptées au vécu de l’enfant, et non le résultat des « a priori », des tabous ou des limites. Connaître et comprendre ce que vit l’enfant est indispensable afin de pouvoir susciter la discussion et l’échange. Pouvoir accueillir ce processus de sexualisation, c’est aussi pouvoir s’accueillir soi-même, là où l’on est, sans jugement de valeur sur sa propre histoire, sur sa sexualité, sachant que rien n’est définitif. Être conscient que la sexualité est un processus peut nous permettre de relativiser et d’accroître nos compétences en tant que parents.
Valérie Chaumeil poursuit la soirée en proposant au public, un moment de réflexion personnelle :
Comment se sont passées pour vous, à l’adolescence, les transformations physiques ?
Il y a-t-il quelqu’un ou quelque chose qui vous a donné envie d’être un homme ou une femme ?
Qu’est-ce que vous aimeriez transmettre à vos enfants en ce qui concerne la sexualité ?
L’objectif de cet exercice était de nous faire prendre conscience de nos limites, de nos points forts et de nos points faibles sur ce sujet. Cela nous amène à nous rendre compte de l’influence de nos valeurs et de nos croyances. En effet, nous transmettons ce que nous sommes, ce que nous vivons dans notre propre sexualité, par exemple que pensons-nous des hommes et des femmes, avons-nous les mêmes valeurs pour notre fils ou notre fille, à partir de quel moment, estime-t-on, que son enfant sort du « droit » chemin ? Car en tant qu’adulte, nous sommes des exemples pour nos enfants.
Quel est le rôle des parents ? Il n’y a pas un âge ou parler de sexualité mais des opportunités, des évènements qui nous offrent des occasions de parler de sexualité avec nos enfants. Mais cela demande de la délicatesse, chaque enfant a un rythme différent.
Quatre composantes sont importantes à tenir en compte lorsque l’on parle d’identité sexuelle :
La composante cognitive : Aujourd’hui nous avons une facilité d’informations sur le sujet, il n’empêche qu’il y a de grandes lacunes en matière de communication. L’enfant a besoin de connaître les valeurs familiales et culturelles de ses parents pour construire son identité, y compris sexuelle. Nous devons alors, en tant qu’adulte, nous positionner; se positionner, c’est mettre des mots et poser des normes car nous-mêmes sommes également soumis à des lois et c’est important qu’ils l’intègrent. La transgression fait partie du développement du jeune et elle est à différencier d’un comportement qui met en danger. Par exemple, satisfaire sa curiosité (cassettes, magazines) ne représente pas le même enjeu que d’avoir des relations sexuelles sans préservatif même s’il est nécessaire de faire prendre conscience aux jeunes que réduire la sexualité à la pornographie serait vraiment dommage. La prévention face à l’inceste, la pédophilie, l’exhibitionnisme est indispensable, il est nécessaire d’apporter des explications quant à la réalité qu’il existe des adultes qui dysfonctionnent en terme de sexualité. Nous avons au moins les moyens de protéger nos enfants par l’information.
La composante émotionnelle : Ce n’est pas uniquement le fait d’avoir deux chromosomes XX qui permet de se sentir femme. En effet, la sexualité n’est pas que fonctionnelle mais contient une composante émotionnelle. C’est l’adulte du même sexe qui va conforter l’enfant dans son identité sexuelle, ce qu’on appelle l’assertivité sexuelle (terme canadien qui signifie la capacité à être aimé, désiré et de le montrer) alors que le parent de l’autre sexe consolide les acquis, qui rassure l’enfant dans ce qu’il fait de bien, peut l’entendre et le soutenir dans ses choix amoureux. Il ne s’agit pas cependant de faire de l’exhibitionnisme (ne pas raconter sa vie sexuelle à son enfant) par contre on peut transmettre le sentiment amoureux : expliquer les élans, les hésitations que l’on a eu en étant plus jeune à ses enfants.
La composante physiologique : Le jeune va découvrir aussi d’un point physiologique sa sexualité. Il s’agira pour le parent d’avoir une attitude dédramatisante et permettre ainsi au jeune d’accueillir ses propres sensations sans culpabilité. Rappelons dans le cadre de ce point, que l’homosexualité n’est pas une identité mais un code d’attraction qui peut être une première expérimentation passagère. Mettre des mots sur les sensations n’est cependant pas si simple… ne peut-on pas reconnaître que parfois l’on ne sait pas avec cette possibilité de renvoyer l’enfant vers d’autres personnes ou sources d’informations ?
La composante relationnelle : La sexualité, c’est aussi être en relation et développer des aptitudes de séduction ; soutenir le jeune dans l’approche de l’autre, c’est lui permettre d’apprendre à vivre un rapport équilibré et une fluidité entre le cœur et le corps.
Marie-José Lacasa et Valérie Chaumeil nous ont rappelé:
« Si l’adolescent ne veut pas parler de sexualité avec ses parents, ce n’est pas grave, il le fera alors avec ses « potes » ou des proches. L’adolescence est une période de transition et de construction de l’identité. Les adolescents ne se sont pas appropriés leurs corps d’autant plus qu’ils sont confrontés au regard de l’autre. » Françoise Dolto en parle dans son ouvrage « Le complexe du homard ».
En tant que parents, nous sommes des acteurs précieux. Accueillir, être disponible et laisser la porte ouverte est essentiel afin d’accompagner nos enfants dans leur processus de sexualisation et ainsi comprendre qu’un certain nombre d’expériences sont nécessaires à la construction de leur identité sexuelle.
Nous notons également des inquiétudes:
Des critiques de la part du public autour de l’impact des médias sur les jeunes : « Maintenant, dans les médias, exagération de la sexualité visible très jeune chez les jeunes filles (string à l’école), ne viole-t-on pas l’innocence des enfants ? Ne véhicule-t-on pas l’image de la femme-objet ? », « Avant, quand on allait acheter un magazine osé, on devait affronter le regard de la vendeuse, maintenant les jeunes sont devant Internet, il n’y a pas de relationnel », débat très intéressant qui pourra être repris à l’occasion de prochaines soirées à thème.
Pour la Maison de quartier des Eaux-Vives, Catherine Vionnet
Livre de la semaine
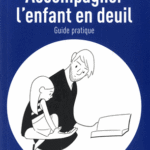
Accompagner l’enfant en deuil