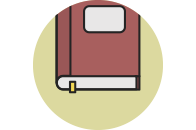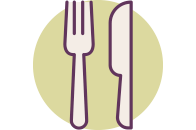Le matin, ne boudons pas les tartines

Lettre du mercredi 11 novembre 2015 - Source: Echo Magazine
Depuis la rentrée des classes, le premier repas de la journée est sur le gril, pour le meilleur et pour le pire. Selon les dernières enquêtes françaises, le déjeuner, pourtant considéré en 2013 comme «indispensable» par plus de 90% de la population, confirme son recul: 30% des enfants et 20% des adultes font l’impasse sur cette collation au moins une fois par semaine. Bien plus, à l’école primaire, près d’un enseignant sur deux constate que des élèves arrivent en classe le ventre vide, et ce quasi quotidiennement dans 40% des cas.
Le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) tire la sonnette d’alarme sur les mauvaises habitudes des Français. En même temps sort en librairie un Petit éloge du petit déjeuner signé Thierry Bourcy, réalisateur et scénariste. Son texte tendre et savoureux devrait nous réconcilier avec ce «moment plutôt joyeux qui, même s’il est solitaire, effectue une douce transition entre les ombres de la nuit et les occupations du jour», écrit en préambule cet auteur né en 1955.
«À table!»
A cette époque, le déjeuner est encore une institution, comme les autres repas de la journée. «C’était un rituel familial inscrit dans un temps pris en commun, car on se levait tous plus tôt et les horaires étant beaucoup plus homogènes», observe Pascale Hébel, directrice du département consommation au CRE-DOC. «Dans une société très cadrée, des règles de comportement définissaient des manières d’exister, et notamment les manières de la table, établies pour toutes les couches de la société, ajoute le sociologue Jean-Claude Kaufmann. Le déjeuner était un repas comme les autres, on appelait `A table!’ et on mangeait tous ensemble, à heure fixe, lavés et habillés, en se tenant bien droit devant son bol et ses tartines. Ce rituel collectif structurait la vie quotidienne.» Au début des années 1960 s’amorce un processus d’autonomisation de l’individu, chacun cherchant à devenir maître de son existence et de ses choix. Les modes de vie se transforment. Les repas évoluent. Aujourd’hui, «le déjeuner est le plus attaqué par l’individualisation des pratiques», observe le sociologue, qui souligne «la perte de ce rituel obligatoire, collectif et Structurant». «Ce repas a perdu de son importance, il n’est plus considéré comme un moment de partage, il est pris de plus en plus seul et de plus en plus rapidement. Il devient aussi plus nomade, sous forme de biscuits à emporter», confirme Pascale Hébel.
Caché derrière les céréales
Souvent vite expédié, le déjeuner, à horaires variables, n’est plus le même pour tout le monde. Dans un objectif de gain de temps, chacun adopte son rythme personnel. «Il peut y avoir plusieurs ‘solos’ au sein d’une même famille», remarque Jean-Claude Kaufmann. L’un avale son café au saut du lit, dans la cuisine, en écoutant la radio; l’autre prend sa douche avant de se préparer son plateau-repas, l’ado mutique se cache derrière sa boîte de céréales pour éviter d’attirer l’attention, le petit dernier avale son biberon de chocolat en regardant un dessin animé à la télévision. Ce qui n’empêche pas les parents de parler à leur progéniture d’une autre pièce en étant occupés à autre chose. Un repas plus libre, plus souple, sans cadre éducatif pesant, qui laisse à chacun une part d’autonomie et permet de faire passer des messages en évitant le face-à-face. «Ce temps matinal correspond aussi à une phase de transition, de remise en route de la machinerie identitaire durant laquelle on échange avec soi-même sans être forcément disponible pour les autres», analyse le sociologue.
Fatigue et distraction
Plus inquiétante, la tendance — notamment chez les plus jeunes — à sauter régulièrement le déjeuner, avec ses répercussions en classe: fatigue, concentration, attention et participation moindres. Plusieurs raisons sont à l’origine de cette esquive. Familiale, lorsque les parents qui travaillent partent avant l’enfant, qui se retrouve seul, un peu livré à lui-même, et n’a pas toujours le réflexe de manger. Socio-économique quand la baisse du pouvoir d’achat incite les ménages les phis modestes à sacrifier le déjeuner au profit des deux autres repas.
Autre cause mise en avant, le décalage de l’heure du coucher et la baisse du temps de sommeil. «L’enfant se couche trop tard, ne dort pas suffisamment, se lève au dernier moment et zappe ce premier repas de la journée. Même s’il vient à table, il n’a pas faim parce qu’il est fatigué. Le déjeuner est la victime collatérale du manque de sommeil», déplore Laurence Plumey, nutritionniste. Le manque d’appétit le matin peut aussi être dû à un souper trop tardif la veille. Dans ce cas, préconise la spécialiste, «il faut revoir l’organisation familiale: prévoir un souper léger et surtout coucher l’enfant plus tôt».
La «famille Ricoré» des années 1980, rassemblée autour de la table, est-elle définitivement enterrée? Rien n’est moins sûr, selon Jean-Claude Kaufmann, persuadé que chaque famille continue d’inventer ses propres rituels. Il y a des «moments famille Ricoré»: un déjeuner pris ensemble une fois par semaine ou pendant les vacances, en retrouvant une forme de cérémonial. Une façon aussi, pour les parents, de donner l’exemple et de transmettre le plaisir du déjeuner.
Laurence Plumey recommande un déjeuner complet et équilibré, composé d’un produit céréalier (pain, céréales en flocons, biscuits), un produit laitier (lait, fromage ou yoghourt) et d’un fruit coupé (ou en jus). Le trio gagnant, dit-elle, pour éviter le fameux coup de pompe de 11 heures. «Certains parents pensent compenser en glissant un biscuit dans le cartable, mais il n’est pas sûr que l’enfant ose le prendre sous le regard des autres ou qu’il en ait seulement le droit», alerte le médecin nutritionniste. Des initiatives existent pour organiser une collation lors de l’accueil des élèves. Mais rien n’est institutionnalisé au niveau scolaire. En attendant, le déjeuner reste une affaire de famille.
France Lebreton/La Croix
Livre de la semaine

Genève dans son changement