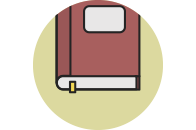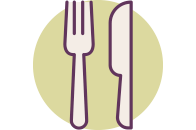On ne dit pas assez aux jeunes à quel point ce n’est pas facile de vivre

Lettre du mercredi 15 octobre 2025 - Source: Tribune de Genève
Cette semaine nous mettons en lumière de Judith Monfrini publié dans la Tribune de Genève du 9.10.25 “On ne dit pas assez aux jeunes à quel point ce n’est pas facile de vivre”.
À Genève, le mal-être des jeunes inquiète. Entre incertitudes sur l’avenir, tension sociale et flux d’informations anxiogènes, les 15-25 ans peinent à trouver leur place. Pour la Dre Anne Edan, psychiatre et responsable de l’unité de crise Malatavie, il faut rappeler une évidence souvent tue : « On ne dit pas assez aux jeunes à quel point il est difficile de vivre. »
” La psychiatre Anne Edan, responsable de l’unité de crise Malatavie, s’exprime sur le mal-être des 15-25 ans et rappelle que les adolescents sont des «éponges».
Une personne sur deux souffrira de troubles psychiques une fois dans sa vie en Suisse, selon le Département genevois de la santé et des mobilités. Face à cet enjeu majeur, le Canton a invité la population à discuter du thème de la santé mentale tout au long de la semaine (voir encart).
À cette occasion, nous avons interrogé Anne Edan, psychiatre et pédopsychiatre, psychothérapeute, médecin adjointe responsable de l’unité de crise «Malatavie», structure créée grâce à un partenariat public-privé avec Children Action.
Dre Anne Edan, on dit beaucoup que les jeunes ne vont pas bien. Qu’en est-il?
Les jeunes de 15-25 ans disent qu’ils vont moins bien si l’on s’appuie sur les autoquestionnaires remplis en ligne (exemple: Primo) qui leur sont adressés. Que faire de cette souffrance exprimée dans un autoquestionnaire?
D’un côté, on peut se réjouir que les intéressés se mettent à parler d’un phénomène souvent passé sous silence. D’un autre côté, ce n’est pas forcément un signe de mauvaise santé mentale: il existe des raisons objectives de ne pas aller si bien que cela en ce moment. Il n’y a aucune raison que les jeunes soient épargnés par un climat global assez dépressogène. Cela concerne aussi bien les perspectives d’avenir et l’écologie que les enjeux politiques actuels et les conflits armés de plus en plus proches, dont parlent énormément les médias.
Il est impossible d’échapper à ces informations. Le climat global interroge les enjeux de liens, qui font l’objet de questionnements à l’adolescence. Ce que l’actualité met en avant, c’est à quel point les liens peuvent être dangereux. Peut-on éviter d’être ensemble parce que c’est difficile? C’est aussi très compliqué d’être tout seul. Être en lien n’est pas aussi évident et simple qu’on aimerait le croire.
Vous voulez dire que les jeunes gens s’interrogent sur les liens qu’ils entretiennent avec leurs familles, leurs amis, leurs amoureux?
Ce sont des interrogations propres à l’adolescence, à savoir: que suis-je pour les autres et que sont-ils pour moi, que me veulent-ils? Je songe particulièrement aux questions omniprésentes de harcèlement et de cyberharcèlement. Comment vivent-ils ce qui leur arrive?
Il y a celui qui se sent victime, celui qui se sent coupable et celui qui se dit pourquoi moi ou pourquoi eux? Qu’ai-je donc fait? Ils sont beaucoup dans l’introspection. Souvent, ils interprètent une maladresse ou un manque d’élégance comme du harcèlement. Ne vont-ils pas trop loin? Ne les aide-t-on pas à surinterpréter, à voir un monde toxique rempli de méchants ou de monstres?
Qui les aide à penser ainsi? Les réseaux sociaux? L’entourage?
Peut-être est-ce l’écho ou la résonance que l’on peut donner à ces choses. Si ça ne va pas, la tendance est de chercher un responsable. On ne redit pas suffisamment à quel point ce n’est pas facile de vivre, d’être avec les autres et même d’aimer. Ce n’est finalement pas rendre service aux adolescents de leur faire croire que les relations sont aisées.
On a beaucoup parlé de tordre le cou au mythe du prince charmant, il faudrait peut-être tordre le cou au mythe des relations harmonieuses. Ce n’est pas évident d’être avec autrui, avec le monde autour de soi. Il y a des choses cruelles et féroces qui se passent entre les ados, elles se passent aussi entre adultes ainsi qu’entre adultes et adolescents. L’abus existe néanmoins, mais il s’agit de s’appuyer sur le discours de l’adolescent, d’évaluer avec lui ce qui l’a fait souffrir et non de présupposer un traumatisme.
Comment les jeunes sont-ils atteints par ce climat anxiogène, est-ce à travers les réseaux sociaux qui diffusent davantage d’informations?
L’influence des écrans est grande. Il faudrait presque s’interroger sur la santé mentale de quelqu’un qui ne serait pas angoissé par ce que l’on voit et entend. L’angoisse naît de l’inconnu, de la crainte de ce que l’humanité va devenir. C’est aussi un premier pas pour décider de changer les choses. De nombreux jeunes, d’ailleurs, militent. L’angoisse est un levier, c’est l’affect qui ne trompe pas, on ne peut pas tricher avec elle. Il y a une légitimité dans l’angoisse et il faut s’y intéresser. C’est aux jeunes de nous renseigner. Le thérapeute explore avec eux les émotions ressenties lorsque l’anxiété surgit, les tentations qui peuvent émerger, notamment les pensées suicidaires. Un de nos patients avait écrit dans le livre d’or de Malatavie: «Le suicide est une mauvaise réponse à une bonne question.» Le travail du thérapeute est de décaler la quête d’une réponse vers l’intérêt des questions: «Vous voulez répondre à quelque chose, notre travail est de comprendre quelle est la question posée et quelles sont les autres questions qui en découlent.»
Les adultes ont-ils une part de responsabilité dans le mal-être de la jeunesse?
Il faut s’interroger sur le modèle d’identification offert aux jeunes. Les adultes eux-mêmes ont peur. Certains psychiatres se sont penchés sur la dépressivité des parents comme source de la dépression des adolescents. Par ailleurs, les adolescents ont un côté «éponge»: ils nous renvoient une caricature de nous-mêmes, nous les adultes.
Certains jeunes gardent néanmoins ce fort élan vital et investissent leurs études et leurs relations. Les rapports sont moins verticaux qu’il y a cinquante ans, les adultes ne veulent plus incarner le vieux rabat-joie pour les générations à venir. Aujourd’hui, de nombreux parents souhaitent demeurer encore un peu un «adolescent».
Que dire aux parents dont les adolescents souffrent?
La première chose est de ne pas rester seul. En tant que parent, il est nécessaire de se poser des questions, essayer de faire équipe, même en cas de séparation. Malatavie a ouvert un groupe de parents à tous ceux qui se sentent en difficulté avec leurs enfants. Être parent consiste à soigner, éduquer, faire confiance et laisser grandir. Ces tâches sont rendues très compliquées lorsque leur enfant pense au suicide. L’urgence est qu’ils reprennent confiance en leur qualité de parent et pour cela qu’ils puissent rencontrer d’autres parents ou éventuellement faire appel à des lignes d’écoute au moindre doute. La ligne ados de Malatavie (022 372 42 42) est gérée par des professionnels qui évaluent la situation. D’autres lignes comme La Main Tendue (143) et Là pour toi (147) offrent également une écoute attentive.”
Liens utiles :
Bien-être en baisse chez les jeunes – Réseau suisse des droits de l’enfant – Actualités 2023 – 02.11.2023
La jeunesse suisse, entre anxiété et dynamisme – Swiss Community – 18.07.2025 – Denise Lachat
Autres adresses :
Malatavie Ligne Ados (HUG – Children Action) 022 372 42 42 : Lieu de consultation, d’information et d’orientation à disposition : des adolescents, jeunes adultes à risque suicidaire ou concernés par la problématique du suicide, de leurs proches (famille, amis), des professionnels (médecins, enseignants, infirmiers, éducateurs, psychologues, assistants sociaux, etc.).
Pro Juventute – Écoute et conseils jeunes (composer le 147) : La Fondation a mis en place une ligne téléphonique pour les jeunes afin qu’ils puissent discuter de leur questions et de leur problèmes.
La main tendue – Écoute et conseils (composer le 143) : La ligne d’écoute pour les soucis et les crises de toutes sortes
Stopsuicide : L’association dont la mission est de parler, faire parler, informer, sensibiliser et augmenter les possibilités de prévention.
Livre de la semaine
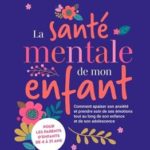
La santé mentale de mon enfant
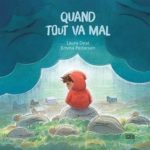
Quand tout va mal

Tenir debout – 60 regards inspirants sur la santé mentale