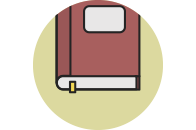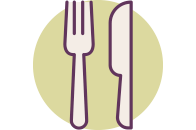Question de ginette
que faire lorsque l'ado a terminé sa scolarité obligatoire et ne veut plus poursuivre d'études
Réponse de Familles GenèveBonjour, Nous vous conseillons de prendre contact avec Tremplin-Jeunes, qui est un service de l'Office d'orientation et de formation professionnelle spécialisé pour l'accueil des jeunes entre 15 et 20 ans qui ont quitté leur scolarité sans avoir terminé une formation scolaire et professionnelle. Tremplin-Jeunes - quai du Rhône 10 - 1205 Genève - Téléphone 022/ 327 70 25 Heures d'ouverture: Tous les après-midi, du lu au ve de 13h30 à 17h30. Tremplin-jeunes Voici encore une réflexion a propos des échecs scolaires chez les adolescents, extrait du livre l'Adolescence de Philippe JEAMMET éditions Solar. Pourquoi un adolescent semble-t-il manquer totalement de motivation pour travailler? Même si sa désinvolture apparente pourrait le laisser croire, ce n'est jamais un signe de bien-être et d'épanouissement, mais un signe de manque de confiance en soi dont les raisons sont complexes et variables. Elles peuvent aussi bien être liées à la peur de l'adolescent de décevoir, a un manque de confiance dans ses capacités à répondre à ce qu'on lui demande, qu'à sa peur de s'affirmer et de montrer son envie d'occuper la première place, voire d'écraser les autres de sa supériorité. Car, en réalité, sentiments d'infériorité et de supériorité ne sont que les deux faces de l'envie d'occuper une place unique, d'être au centre de l'attention. Mais si la réussite est aléatoire, dépend de l'opinion des autres et n'est jamais acquise, l'échec, surtout quand on en est soi-même responsable, est toujours sûr et entièrement maîtrisé. C'est-à-dire que l'adolescent peut penser inconsciemment : «Si je travaille et que je n'ai pas les résultats escomptés, on va penser, et moi le premier, que je ne suis pas aussi capable que je l'espérais. Si je ne travaille pas, il n'y a rien d'étonnant a ce que je ne réussisse pas, et on peut toujours penser que si je travaillais, je réussirais... » La paresse apparente protégé de la déception d'un échec possible, surtout quand l'idéal de réussite est très élevé - peut-être trop -, qu'il paraît donc hors de portée et fait, par contraste, se sentir inférieur. Un sentiment d'infériorité est toujours relatif; il se nourrit d'exigences excessives et de désirs de grandeur. Les idéaux familiaux tiennent une place importante dans la façon dont l'adolescent conçoit sa réussite; il se positionnera différemment selon celle des autres membres de la famille, d'une façon d'ailleurs souvent imprévisible, car très différente selon les circonstances. Tel adolescent se sentira soutenu et même tiré vers le haut par la réussite de ses parents et/ou de ses frères et soeurs tandis que tel autre refusera la concurrence et choisira, souvent inconsciemment, de prendre le parti du dilettantisme. Selon son sexe, la rivalité jouera différemment entre un enfant et ses parents. Un père brillant et une mère en retrait, par exemple, peuvent tout autant servir de modèle que de contre-modèle aux enfants du même sexe. La fille peut vouloir ressembler à son père ou se l'interdire par peur de dépasser sa mère. De même pour un garçon; tous les positionnements sont possibles et peuvent se succéder en fonction des événements et de l'évolution personnelle de chacun. Une des situations types de l'adolescent en échec scolaire est celle du garçon ayant vécu jusqu'alors porte par l'admiration et l'attention soutenue de sa mère. Avec la puberté l'adolescent se sent obligé de prendre de la distance, gêné par cette proximité affective et physique et désireux de s'affirmer par lui-même. Mais cette distance, la relative solitude qu'elle implique, le fait que personne ne puisse vraiment remplacer cette mère et son regard admiratif, contribuent à déprimer le jeune homme. Seul, il a du mal à travailler et à se concentrer. Il s'évade dans des rêveries, va rechercher des appuis divers : télévision, musique, lectures, amis, ou autres passe-temps moins anodins. La chute de ses résultats scolaires n'arrange rien : il se déçoit et pense décevoir ses parents. Il va chercher la compréhension qu'il pense ne pas trouver chez lui auprès d'amis qui lui ressemblent, ayant le sentiment d'être accepté par eux pour lui-même, quoi qu'il arrive, comme autrefois avec sa mère. Il peut arriver que cette recherche d'un réconfort mutuel dérive progressivement, les adolescents s'entraînant les uns les autres à consommer haschich ou alcool. L'échec de l'adolescent se confirme : ses résultats scolaires lui barrant la route de ses ambitions, autant être grand dans l'échec, à défaut de l'être dans la réussite. Sa mère ou son père veulent l'aider, le faire travailler, ce qui ne fait qu'empirer la situation, transformer la vie familiale en une série d'incessants conflits. Tout plaisir Partage avec ses parents l'exaspère, comme si ceux-ci n'étaient capables de l'aimer qu'en vertu des satisfactions qu'il peut leur procurer. Avoir une bonne note équivaut pour lui a se soumettre à ses parents, à redevenir l'enfant choyé et adulé d'autrefois qu'il rejette d'autant plus violemment qu'il sait qu'il en garde une nostalgie inguérissable. Il ne se sent lui-même, menant une existence propre, différente de celle de ses parents, que dans ce qui les navre. Plus ceux-ci essaient de cacher leur déception, de se montrer compréhensifs, plus il a envie et besoin de les décevoir et de les provoquer. Alors que l'on constate souvent que, si les parents acceptent de mettre une distance entre eux et l'adolescent avant que la situation d'échec ne soit définitive, elle est susceptible de s'inverser. Un séjour en pensionnat, par exemple, peut permettre à l'adolescent, encouragé par le rythme de la vie en groupe, de retrouver goût au travail, lui évitant certaines des tentations auxquelles il était difficile de résister. De plus, il ressentira sa réussite, obtenue hors du regard parental, comme lui appartenant réellement. Rassuré, il pourra alors nouer avec ses parents des liens plus positifs, et d'autant mieux apprécier leur présence qu'il les verra moins souvent. Le résultat d'un tel éloignement n'est bien entendu jamais acquis d'avance et dépend en grande partie de la qualité des rencontres que peut faire l'adolescent. Néanmoins, une mise à distance, quelle qu'elle soit, parait susceptible d'avoir des effets positifs. Les plus difficiles à convaincre sont souvent les parents, qui la vivent comme une punition et un abandon. Ce faisant, ils confirment chez l'adolescent le sentiment qu'il est incapable de se prendre lui-même en charge. Aux parents de comprendre que leur plus grande réussite est de faire en sorte que l'adolescent puisse faire la preuve de ses capacités d'autonomie. Même s'il les a construites a partir de ce qu'il a reçu d'eux, ses réussites lui appartiennent en propre, et il doit s'en persuader. C'est alors seulement qu'il peut revenir vers eux suffisamment sur de lui pour pouvoir s'en rapprocher sans crainte.